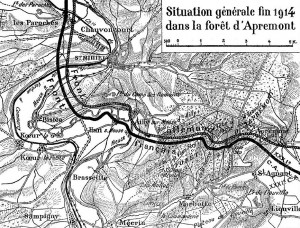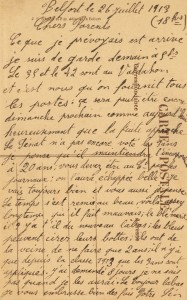Un fantassin au front, se trouve presque en permanence exposé à recevoir des projectiles potentiellement mortels, la plupart du temps envoyés par l’ennemi, mais aussi parfois malheureusement venant de son propre camp (par exemple des tirs trop courts de l’artillerie fançaise tombant sur la première ligne). Et au début de la guerre, les soldats français, contrairement aux soldats allemands n’avaient même pas de casque !
Plutôt que de discourir à ce sujet, je vous livre ci-dessous quelques moceaux choisis, du vécu !
« …les balles continuent à pleuvoir autour de moi, je risque d’être à nouveau atteint ; je fais donc tout mon possible pour me traîner dans un trou, j’ai bien du mal à m’y blottir.…
Quelle affreuse nuit !
Rien que la fusillade, car à chaque bruit que fait un blessé, la fusillade reprend, au beau milieu de la nuit, la mitrailleuse balaye le terrain, les balles me passent par dessus la tête, mais elles ne peuvent plus m’atteindre dans mon trou… »
Lettre du poilu Désiré Renault (22 août 1914)
« …je préférerais être bien loin d’ici que de vivre dans un vacarme pareil. C’est un véritable enfer. L’air est sillonné d’obus… »
Lettre du poilu Alphonse X à sa femme (5 mai 1915) qui sera un mois plus tard tué par un obus
« Les lourdes marmites, par douzaines achèvent de ravager les champs pelés. Elles arrivent en sifflant, toutes ensemble ; elles approchent, elle vont tomber sur nous. Et les corps se recroquevillent, les dos s’arrondissent, les têtes disparaissent sous les sacs, tous les muscles se contractent dans l’attente angoissée des explosions instantanément évoquées, du vol ronflant des énormes frelons d’acier. Mais je vois, tandis que le sifflement grandit encore vers nous, des panaches de fumée noire s’écheveler à la crête; presque aussitôt, le fracas des éclatements nous assourdit. Chaque fois qu’un obus tombe, c’est un éparpillement de gens qui courent en tout sens ; et lorsque la fumée s’est dissipée, on voit par terre, faisant taches sombres sur le jaune sale des chaumes, de vagues formes immobiles. »
Maurice Genevoix, Ceux de 14, p. 66
« …des coups de fusil crépitent à gauche, des balles chantent : elles doivent taper vers la section en marche. Les schrapnells se groupent au-dessus d’elle. La ligne onduleuse s’immobilise, tassée dans un vague pli de terrain, pareille à une longue chenille morte. »
Maurice Genevoix, Ceux de 14, p. 68
« Soudain des sifflements stridents, qui se terminent en ricanements rageurs, nous précipitent face contre terre. Des éclats, des billes cinglent l’air, un gros culot vient en bourdonnant se planter à côté de mon genou.
(…)Les hommes à genoux, recroquevillés, le sac sur la tête, tendent le dos, se soudent les uns aux autres.
Nouveaux grincements, nouvelles explosions. Les billes pleuvent, ricochent sur les gamelles; un bidon percé pisse son vin; une fusée chantonne longtemps dans l’air, comme un méchant moustique… haletants, secoués de tremblements, mes voisins claquent des dents. Leurs visages bouleversés rappellent les grotesques gargouilles de Notre-Dame; dans cette posture de consternation, les bras croisés la tête basse, ils ont l’air de suppliciés qui offrent leur nuque au bourreau.
Le caporal Bidet qui a perdu son képi, me dit entre deux hoquets :
« si ça doit être tous les jours comme ça, j’aime mieux mourir tout de suite !… »
Caporal Galtier – Boissière, la Fleur au Fusil, p. 116-117
Le système nerveux humain n’étant pas adapté à de telles agressions répétées, il va sans dire que les blessures du psychisme n’ont pas manqué d’apparaitre nombreuses chez les combattants et il faudra beaucoup de temps avant que l’on commence à les reconnaître!
Je dédie cet article à mon fils, Damien Jalet, qui en ce moment même, dans l’opéra « Shell shock » à la Monnaie de Bruxelles, danse le rôle d’un soldat sous les obus… pendant la guerre de 14/18